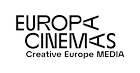ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Après l’amour consommé viennent les pleurs, les larmes de peur de l’amour lui-même. Enveloppée dans une couverture, crachant sa fumée de cigarette entre deux sanglots, Alabama (Patricia Arquette) pleure. Elle vient de rencontrer Clarence (Christian Slater). Au cinéma le projecteur jetait Sonny Chiba sur la toile et Alabama ses popcorns sur Clarence. Après une tarte et quelques mots partagés, l’électricité et la foudre pointent leurs nez. Ils ne se connaissent qu’à peine mais déjà leurs corps furent unis sous les néons bleus de l’amour et de l’imagerie pop d’une époque. Elle pleure, elle est call-girl. Il l’écoute, il est perdu. Ils vont s’aimer et parcourir les huit bandes américaines sous le soleil couchant de Malika, traverser les pluies d’étoiles rouges et de blanche coco pur sucre pour laisser quelques billets verts simuler un espoir de vie meilleure.
On leur aurait demandé de nous aimer qu’ils ne l’auraient pas mieux fait. Ils sont beaux ces deux-là. Ils sont amoureux et nous aussi. Mais comme tous les amoureux, ils sont minuscules. Et ils peuvent bien trimballer toute la coke du monde sur leurs dos, personne ne les écoute. Ils doivent se faire seuls, c’est comme ça aujourd’hui à Détroit la capitale de l’automobile, à Hollywood la plus grande usine du cinéma, faut sortir les griffes. Le monde s’en fout d’eux et même à deux, même à trois on reste seuls face aux autres.
Si Quentin Tarantino – ici, scénariste – déclasse l’œuvre de son style, alors dédouanée de toutes attentes, en offrant son scénario à Tony Scott, sympathique cinéaste aux verbiages esthétiques parfois fatiguant, ce dernier lui insuffle une vision romantique et tamisée d’une Amérique fumeuse de clichés et c’est charmant, touchant, bouleversant.
On ne peut décemment attacher à l’œuvre une réflexion poussée sur l’état d’un espace calciné, d’une époque libertaire aux idées revanchardes. On peut cependant reconnaître la très claire ligne qui joint le film à Badlands (dont il reprend le thème), faisant du plus récent un remake inavoué ou la mise à plat cinéphile et presque autobiographique d’un futur grand cinéaste déchiré de sa simple vérité et de ses fantasmes les plus érotiques, de soleil, d’argent, de sang et d’amour. Mais aussi d’une mise en image et en situation d’une époque pas si lointaine de la nôtre. C’est en ça que le travail de Scott sur cette production apporte un intérêt puisqu’il représente à lui seul une certaine sorte d’images cérébrales des 90’s, époque chargée en espoir comme en désillusion. Et au spectateur de se lover dans cette imaginaire élégant de mauvais goût assumé.
Entre blondeur oxygénée et hémoglobine arc-en-ciel, Scott trouve son ton et dégraisse son style jusqu’à la chair pour épouser les dialogues ciselés de Q.T. et ériger une romance explosive entre deux paumés célestes.
Lucien Halflants (Le passeur critique)
Plans cultes / Soirée St Valentin
mardi 13 février
2018 à 19h45
19h45 : TRUE ROMANCE de Tony Scott
22h00 : FASTER, PUSSYCAT! KILL! KILL! de Russ Meyer
Tarif spécial soirée : 9€ les 2 films sinon tarifs habituels
TRUE ROMANCE
de Tony Scott
avec Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper
USA - 1993 - 2h00 - VOST - Interdit aux moins de 16 ans
A PROPOS
Après l’amour consommé viennent les pleurs, les larmes de peur de l’amour lui-même. Enveloppée dans une couverture, crachant sa fumée de cigarette entre deux sanglots, Alabama (Patricia Arquette) pleure. Elle vient de rencontrer Clarence (Christian Slater). Au cinéma le projecteur jetait Sonny Chiba sur la toile et Alabama ses popcorns sur Clarence. Après une tarte et quelques mots partagés, l’électricité et la foudre pointent leurs nez. Ils ne se connaissent qu’à peine mais déjà leurs corps furent unis sous les néons bleus de l’amour et de l’imagerie pop d’une époque. Elle pleure, elle est call-girl. Il l’écoute, il est perdu. Ils vont s’aimer et parcourir les huit bandes américaines sous le soleil couchant de Malika, traverser les pluies d’étoiles rouges et de blanche coco pur sucre pour laisser quelques billets verts simuler un espoir de vie meilleure.
On leur aurait demandé de nous aimer qu’ils ne l’auraient pas mieux fait. Ils sont beaux ces deux-là. Ils sont amoureux et nous aussi. Mais comme tous les amoureux, ils sont minuscules. Et ils peuvent bien trimballer toute la coke du monde sur leurs dos, personne ne les écoute. Ils doivent se faire seuls, c’est comme ça aujourd’hui à Détroit la capitale de l’automobile, à Hollywood la plus grande usine du cinéma, faut sortir les griffes. Le monde s’en fout d’eux et même à deux, même à trois on reste seuls face aux autres.
Si Quentin Tarantino – ici, scénariste – déclasse l’œuvre de son style, alors dédouanée de toutes attentes, en offrant son scénario à Tony Scott, sympathique cinéaste aux verbiages esthétiques parfois fatiguant, ce dernier lui insuffle une vision romantique et tamisée d’une Amérique fumeuse de clichés et c’est charmant, touchant, bouleversant.
On ne peut décemment attacher à l’œuvre une réflexion poussée sur l’état d’un espace calciné, d’une époque libertaire aux idées revanchardes. On peut cependant reconnaître la très claire ligne qui joint le film à Badlands (dont il reprend le thème), faisant du plus récent un remake inavoué ou la mise à plat cinéphile et presque autobiographique d’un futur grand cinéaste déchiré de sa simple vérité et de ses fantasmes les plus érotiques, de soleil, d’argent, de sang et d’amour. Mais aussi d’une mise en image et en situation d’une époque pas si lointaine de la nôtre. C’est en ça que le travail de Scott sur cette production apporte un intérêt puisqu’il représente à lui seul une certaine sorte d’images cérébrales des 90’s, époque chargée en espoir comme en désillusion. Et au spectateur de se lover dans cette imaginaire élégant de mauvais goût assumé.
Entre blondeur oxygénée et hémoglobine arc-en-ciel, Scott trouve son ton et dégraisse son style jusqu’à la chair pour épouser les dialogues ciselés de Q.T. et ériger une romance explosive entre deux paumés célestes.
Lucien Halflants (Le passeur critique)

A PROPOS
Le chef-d'oeuvre féministe de Russ Meyer, roi du porno soft.
Est-ce un film ou un fantasme global ? Faster, Pussycat! Kill ! Kill ! (ça, c'est du titre) reste le chef-d'oeuvre de Russ Meyer, roi du cinéma d'exploitation coquin (les inénarrables nudies des années 50) devenu une sorte de Tex Avery porno soft aux obsessions mammaires démesurées. Un gentil papy libidineux capable de traverser le monde pour dénicher des filles joliment carénées, qu'il affublera de pseudos délicieux (Kitten Natividad...) dans des oeuvres titillantes, parangons de gaudriole redneck (Vixen, Supervixens, Megavixens et on en passe des giga). Mais revenons à notre affaire. Tourné en noir et blanc, en 1965, dans le désert et pour le prix d'un plein de super, Faster, Pussycat! conte la virée sauvage d'un gang de gogo-girls en cuir. On n'en dira pas plus, d'ailleurs l'histoire n'est qu'un prétexte à décliner tous les fantasmes possibles.
Faster Pussycat!, c'est l'Amérique (un peu comme Tom Sawyer, mais en plus immature), la dernière frontière, le wild wild west. D'ailleurs, le film s'ouvre sur cette sentence : «Welcome to violence !» C'est aussi le cuir, et son corollaire rock, conjugué pour la première fois au féminin, ce qui lui vaudra à jamais la tendresse des lesbiennes, des riot-girls pré-Courtney Love, des dominatrices, des fétichistes ou encore des groupes à guitare high energy de Detroit pré et postpunk (Russ Meyer plancha un temps sur un projet de film avec les Sex Pistols). C'est dire si le spectre est large. On ne compte pas les enfants de Pussycat, que ce soit le photographe-vidéaste Richard Kern, notre Alain Bashung, les Cramps, ou une poignée de clippeurs et de publicitaires (on se souvient d'un quasi-remake pour un déodorant masculin). C'est tout le génie de Meyer que d'avoir su concilier imaginaire hétéro beauf et instinct féministe dépoitraillé.
Philippe Azoury & Alexis Bernier, Libération
FASTER, PUSSYCAT! KILL! KILL!
de Russ Meyer
avec Tura Satana, Haji, Lori Williams
USA - 1965 - 1h24 - VOST - Réédition - Version restaurée - Interdit aux moins de 16 ans
Varla, Rosie et Billie, trois danseuses aussi sexy que folles furieuses, foncent au volant de leurs voitures de sport, après un show dans un Go-Go Club devant un public masculin en sueur (''Go! Baby! Go!''). Avides de sensations fortes, les trois furies font une virée sauvage dans le désert. Elles y rencontrent un couple d'amoureux que Varla n'hésite pas à provoquer. De nature plutôt haineuse, cette dernière extermine le jeune homme... Désormais fugitives, nos walkyries enlèvent la gosse et se lancent dans une folle cavale !
https://www.films-sans-frontieres.com/faster-pussycat-kill-kill/
A PROPOS
Le chef-d'oeuvre féministe de Russ Meyer, roi du porno soft.
Est-ce un film ou un fantasme global ? Faster, Pussycat! Kill ! Kill ! (ça, c'est du titre) reste le chef-d'oeuvre de Russ Meyer, roi du cinéma d'exploitation coquin (les inénarrables nudies des années 50) devenu une sorte de Tex Avery porno soft aux obsessions mammaires démesurées. Un gentil papy libidineux capable de traverser le monde pour dénicher des filles joliment carénées, qu'il affublera de pseudos délicieux (Kitten Natividad...) dans des oeuvres titillantes, parangons de gaudriole redneck (Vixen, Supervixens, Megavixens et on en passe des giga). Mais revenons à notre affaire. Tourné en noir et blanc, en 1965, dans le désert et pour le prix d'un plein de super, Faster, Pussycat! conte la virée sauvage d'un gang de gogo-girls en cuir. On n'en dira pas plus, d'ailleurs l'histoire n'est qu'un prétexte à décliner tous les fantasmes possibles.
Faster Pussycat!, c'est l'Amérique (un peu comme Tom Sawyer, mais en plus immature), la dernière frontière, le wild wild west. D'ailleurs, le film s'ouvre sur cette sentence : «Welcome to violence !» C'est aussi le cuir, et son corollaire rock, conjugué pour la première fois au féminin, ce qui lui vaudra à jamais la tendresse des lesbiennes, des riot-girls pré-Courtney Love, des dominatrices, des fétichistes ou encore des groupes à guitare high energy de Detroit pré et postpunk (Russ Meyer plancha un temps sur un projet de film avec les Sex Pistols). C'est dire si le spectre est large. On ne compte pas les enfants de Pussycat, que ce soit le photographe-vidéaste Richard Kern, notre Alain Bashung, les Cramps, ou une poignée de clippeurs et de publicitaires (on se souvient d'un quasi-remake pour un déodorant masculin). C'est tout le génie de Meyer que d'avoir su concilier imaginaire hétéro beauf et instinct féministe dépoitraillé.
Philippe Azoury & Alexis Bernier, Libération