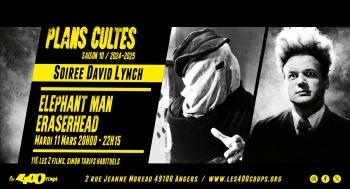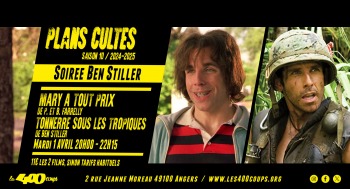ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPECIALES

A PROPOS
Inutile de tergiverser, Nosferatu, une symphonie de l’horreur par Murnau est LE film ultime de vampire parce qu’il a projeté sur un écran le mythe pour ce qu’il est réellement : un prédateur, malade, condamné par sa condition, à aspirer la vie d’autrui pour subsister. Sans fioriture. Sans romantisme non plus. A ce titre, l’explication de sa résistance aux outrages du temps est double.
Premièrement, n’en déplaise à feu la veuve Stoker qui a cherché par tous les moyens à détruire les copies en circulation, Murnau est le seul avec Werner Herzog (dans une moindre mesure) a avoir su transcender sur pellicule l’esprit maléfique du roman matriciel. En effet, le changement des noms, des lieux et le passage sous silence des référents chrétiens mis à part, on a bien affaire à une adaptation de Dracula… jusqu’à la narration rythmée par les correspondances postales et les journaux intimes. Cependant, il est moins question dans Nosferatu d’une lutte entre le Bien et le Mal que d’un conflit entre l’homme civilisé et sa bestialité latente. Point de cape en velours, de séduction cannibale ou de fripes en provenance d’Orient comme chez Coppola, ici, le comte Orlock est véritablement un cadavre ambulant, repoussoir au genre humain. Max Schreck demeurera pour l’éternité ce grand échalas blafard dentu, aux doigts démesurément crochus, affublé d’oreilles démoniaques. Autant être clair, toutefois, des yeux blasés comme les nôtres qui en ont vu d’autres depuis ne sursauteront pas devant ces méfaits. Sa force est ailleurs, pas tant dans l’effroi primaire que dans ce malaise persistant qu’il suscite.
Ce qui nous conduit au deuxième point. Le coup de génie de Murnau repose sur sa volonté de placer Nosferatu à la croisée incertaine de deux chemins, entre expressionnisme et réalisme dans le sens où une grande partie du tournage s’est déroulée dans des décors réels. Excellemment secondé par son directeur artistique Albin Grau (un obsédé de sciences occultes), Murnau nimbe ses paysages, qu’ils soient ruraux ou urbains, d’une dimension anonyme, conférant par là même à son récit une universalité salutaire. A partir de là, le comte Orlock devient la métaphore idéale de n’importe quel monstre à visage humain (tueur, violeur, cannibale, etc.). Voilà pourquoi Nosferatu demeurera pour très longtemps encore le fleuron du genre… un statut qui peut aussi se comprendre par son mutisme. Il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, de le remaker à la lettre à cause d’une grammaire actorielle et d’un emploi des cosmétiques proprement obsolètes.
Ne pas voir cette affirmation comme un signe manifeste de condescendance. Ce serait très malvenu lorsque l’on se penche sur la mise en scène résolument avant-gardiste de Murnau. Au-delà de scènes inoubliables comme la sortie du cercueil de Orlock raide comme un piquet (brrr !!), le cinéaste allemand emploie avec maestria le montage alterné (commun aujourd’hui mais plutôt rare en 1922), fait montre de précision dans la composition de ses cadres (dans les lisières pour être plus précis) ; quand la lumière expressionniste de l’acte 5 ne nous marque pas durablement avec cette ombre gigantesque d’une main saisissant à pleine poignée le cœur de sa proie. Murnau n’hésite pas non plus à recourir à des trucages aussi simples que redoutablement efficaces, qu’il s’agisse des variations de vitesse de défilement (la calèche maléfique se déplaçant comme un rat), de faire jouer Schreck à l’envers ou le stop motion accentuant la démarche lugubre du vampire.
Julien Foussereau (Ecran Large)
Avant-Première / Nosferatu Night !
vendredi 20 décembre
à 19h00
19h00 : NOSFERATU LE VAMPIRE (1922)
suivi de l'avant-première
21h00 : NOSFERATU (2024)
Tarif spécial Nosferatu : 11€ les 2 films sinon tarifs habituels
NOSFERATU LE VAMPIRE
de F.W. Murnau
avec Max Schreck, Greta Schroeder, Gustav von Wangenheim
ALLEMAGNE - 1922 - 1h34 - Muet - Version restaurée 2K
En 1838, Thomas Hutter, commis d’agent immobilier, quitte sa jeune femme Ellen pour le château du comte Orlok dans les Carpates. Là-bas, Hutter découvre que le comte est en fait Nosferatu le vampire et est victime des morsures répétées du monstre. Celui-ci quitte son château dans un cercueil rempli de terre et, après un voyage en voilier au cours duquel il décime l’équipage terrorisé, va prendre livraison de sa nouvelle demeure, située face à celle de Hutter et Ellen…
A PROPOS
Inutile de tergiverser, Nosferatu, une symphonie de l’horreur par Murnau est LE film ultime de vampire parce qu’il a projeté sur un écran le mythe pour ce qu’il est réellement : un prédateur, malade, condamné par sa condition, à aspirer la vie d’autrui pour subsister. Sans fioriture. Sans romantisme non plus. A ce titre, l’explication de sa résistance aux outrages du temps est double.
Premièrement, n’en déplaise à feu la veuve Stoker qui a cherché par tous les moyens à détruire les copies en circulation, Murnau est le seul avec Werner Herzog (dans une moindre mesure) a avoir su transcender sur pellicule l’esprit maléfique du roman matriciel. En effet, le changement des noms, des lieux et le passage sous silence des référents chrétiens mis à part, on a bien affaire à une adaptation de Dracula… jusqu’à la narration rythmée par les correspondances postales et les journaux intimes. Cependant, il est moins question dans Nosferatu d’une lutte entre le Bien et le Mal que d’un conflit entre l’homme civilisé et sa bestialité latente. Point de cape en velours, de séduction cannibale ou de fripes en provenance d’Orient comme chez Coppola, ici, le comte Orlock est véritablement un cadavre ambulant, repoussoir au genre humain. Max Schreck demeurera pour l’éternité ce grand échalas blafard dentu, aux doigts démesurément crochus, affublé d’oreilles démoniaques. Autant être clair, toutefois, des yeux blasés comme les nôtres qui en ont vu d’autres depuis ne sursauteront pas devant ces méfaits. Sa force est ailleurs, pas tant dans l’effroi primaire que dans ce malaise persistant qu’il suscite.
Ce qui nous conduit au deuxième point. Le coup de génie de Murnau repose sur sa volonté de placer Nosferatu à la croisée incertaine de deux chemins, entre expressionnisme et réalisme dans le sens où une grande partie du tournage s’est déroulée dans des décors réels. Excellemment secondé par son directeur artistique Albin Grau (un obsédé de sciences occultes), Murnau nimbe ses paysages, qu’ils soient ruraux ou urbains, d’une dimension anonyme, conférant par là même à son récit une universalité salutaire. A partir de là, le comte Orlock devient la métaphore idéale de n’importe quel monstre à visage humain (tueur, violeur, cannibale, etc.). Voilà pourquoi Nosferatu demeurera pour très longtemps encore le fleuron du genre… un statut qui peut aussi se comprendre par son mutisme. Il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, de le remaker à la lettre à cause d’une grammaire actorielle et d’un emploi des cosmétiques proprement obsolètes.
Ne pas voir cette affirmation comme un signe manifeste de condescendance. Ce serait très malvenu lorsque l’on se penche sur la mise en scène résolument avant-gardiste de Murnau. Au-delà de scènes inoubliables comme la sortie du cercueil de Orlock raide comme un piquet (brrr !!), le cinéaste allemand emploie avec maestria le montage alterné (commun aujourd’hui mais plutôt rare en 1922), fait montre de précision dans la composition de ses cadres (dans les lisières pour être plus précis) ; quand la lumière expressionniste de l’acte 5 ne nous marque pas durablement avec cette ombre gigantesque d’une main saisissant à pleine poignée le cœur de sa proie. Murnau n’hésite pas non plus à recourir à des trucages aussi simples que redoutablement efficaces, qu’il s’agisse des variations de vitesse de défilement (la calèche maléfique se déplaçant comme un rat), de faire jouer Schreck à l’envers ou le stop motion accentuant la démarche lugubre du vampire.
Julien Foussereau (Ecran Large)

A PROPOS
Par une nuit bleutée, la jeune Ellen marche jusqu’à sa fenêtre ouverte, pas tant somnambule que possédée. Sur les rideaux flottant dans la brise se découpe une silhouette massive, mais immatérielle. De fait, personne ne se tient là. Avec cette image inquiétante, tout à la fois simple et puissamment évocatrice, Robert Eggers donne le ton pour son remake de Nosferatu. Infusant une splendeur lugubre à chaque plan, le réalisateur livre son film le plus ensorcelant depuis The Witch (La sorcière).
L’histoire est connue : tandis qu’un jeune notaire (Nicholas Hoult) dépêché par sa firme dans un lointain château tente d’échapper à son hôte vampire (Bill Skarsgård), ce dernier entreprend d’aller convaincre l’épouse (Lily-Rose Depp) de son malheureux captif de le rejoindre dans l’éternité des damnés.
Sorti en 1922, le Nosferatu originel est un monument cinématographique. Non seulement F.W. Murnau posait là un jalon de l’expressionnisme allemand, mais il jetait aussi les bases du cinéma d’épouvante. Or, une fois n’est pas coutume, se mesurer à ce chef-d’œuvre précis n’a rien de sacrilège.
D’une part, Werner Herzog a d’ores et déjà prouvé la validité de la démarche en offrant en 1979 un remake magnifique et distinct — du film originel. D’autre part, Nosferatu est, à la base, une adaptation non autorisée de Dracula (1897), de Bram Stoker, roman ayant inspiré un nombre incalculable de films.
Bref, devant la résurrection, si l’on peut dire, de ce vampire-là, il n’y a guère lieu de crier à l’hérésie.
S’il conjugue intelligemment le meilleur des deux Nosferatu précédents, Eggers, comme Herzog avant lui, ne se borne pas à reproduire ce qui est venu avant.
Ainsi, lors des séquences nocturnes, avec cette direction photo tout de noir et de nuances de bleus, on se rapproche de l’effet produit par le noir et blanc contrasté de Murnau jadis. Les macabres tableaux qu’Eggers est si doué pour imaginer sont en ces occasions à leur plus saisissant.
Dans les scènes se déroulant durant le jour, les couleurs sont délavées, exsangues. C’était le cas de la version d’Herzog, qui se caractérisait par un dénuement formel exsudant une poésie sépulcrale. Eggers paraît s’en être inspiré, délaissant la surenchère de son précédent The Northman (L’homme du nord) : un choix heureux qui permet aux quelques élans baroques, car il y en a, de résonner plus fort encore.
Photo: Focus Features Dans les scènes se déroulant le jour, les couleurs du film sont délavées.
À terme, le cinéaste transcende toute notion de mimétisme en insufflant à sa vision gothique un souffle quasi épique. Des passages vus des tas de fois dans les différents Nosferatu et Dracula, telle l’arrivée du carrosse fantôme, voient ainsi leur pouvoir d’envoûtement renouvelé à la faveur d’une mise en scène alliant intimisme et grand déploiement.
Visuellement, ce nouveau Nosferatu est le film le plus ambitieux et sans doute le plus achevé du cinéaste à peine quadragénaire. Il faut dire que le projet était en développement depuis près de dix ans : c’est dire que Robert Eggers a eu tout loisir de visualiser la production dans ses moindres détails.
D’ailleurs, dans un entretien au Devoir à la sortie de The Witch, qui marquait ses remarquables débuts derrière la caméra, Eggers avait cette confidence éloquente : « Dès lors qu’il s’agit d’épouvante, je préfère qu’on s’en remette à l’imagination. Je ne veux pas voir les chevilles de Christopher Lee en Dracula : sa cape doit se fondre avec les ténèbres, comme dans une peinture de Rembrandt. »
Toujours au sujet du premier film d’Eggers : l’Ellen revue et bonifiée de ce Nosferatu-ci a beaucoup en commun avec la Thomasin de The Witch. Dans les deux cas, on parle de jeunes femmes coincées dans des milieux étouffants, aux valeurs étriquées, et qui s’émancipent en embrassant les ténèbres. Fait intéressant : Ralph Ineson joue le patriarche puritain dans The Witch, et le docteur engoncé dans la misogynie ordinaire dans Nosferatu.
À noter qu’Eggers a ajouté ce sous-texte, qu’il renforce en transformant le supposé amour du comte vampire pour Ellen en une soif de domination. Il veut qu’elle se soumette à lui, comme il l’énonce clairement en lui lançant un sinistre ultimatum (dont la teneur engendre des longueurs tardives). Dès lors, la décision finale d’Ellen relève de l’autodétermination : une autre variante inédite.
Photo: Focus Features L’Ellen (Lily-Rose Depp) revue et bonifiée de ce Nosferatu-ci a beaucoup en commun avec la Thomasin de «The Witch».
Dans la même optique, Eggers ouvre son Nosferatu non pas avec Thomas, comme Murnau, mais avec Ellen, comme Herzog. Par la suite, Ellen est souvent celle qui propulse l’action, là où les itérations passées du personnage faisaient un peu figure de potiches apeurées. Quoique, dans le film de 1979, le jeu hanté d’Isabelle Adjani captive.
Parlant d’Adjani, il est évident que sa performance hallucinante dans le culte Possession, d’Andrzej ?u?awski, a en partie inspiré celle, fascinante également, de Lily-Rose Depp. Sa composition habitée, totalement désinhibée, frappe l’imaginaire, à l’instar du film.
Et c’est ainsi qu’à son tour, Robert Eggers réussit à effrayer et à séduire, avec ce Nosferatu pourvoyeur de splendides cauchemars à venir.
François Lévesque (Le Devoir)
NOSFERATU
de Robert Eggers
avec Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Willem Dafoe
USA - 2024 - 2h12 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
Une histoire gothique d'obsession entre une jeune femme hantée dans l'Allemagne du 19ème siècle et l'ancien vampire transylvanien qui la traque, apportant avec lui des horreurs indicibles.
https://www.universalpictures.fr/micro/nosferatu
A PROPOS
Par une nuit bleutée, la jeune Ellen marche jusqu’à sa fenêtre ouverte, pas tant somnambule que possédée. Sur les rideaux flottant dans la brise se découpe une silhouette massive, mais immatérielle. De fait, personne ne se tient là. Avec cette image inquiétante, tout à la fois simple et puissamment évocatrice, Robert Eggers donne le ton pour son remake de Nosferatu. Infusant une splendeur lugubre à chaque plan, le réalisateur livre son film le plus ensorcelant depuis The Witch (La sorcière).
L’histoire est connue : tandis qu’un jeune notaire (Nicholas Hoult) dépêché par sa firme dans un lointain château tente d’échapper à son hôte vampire (Bill Skarsgård), ce dernier entreprend d’aller convaincre l’épouse (Lily-Rose Depp) de son malheureux captif de le rejoindre dans l’éternité des damnés.
Sorti en 1922, le Nosferatu originel est un monument cinématographique. Non seulement F.W. Murnau posait là un jalon de l’expressionnisme allemand, mais il jetait aussi les bases du cinéma d’épouvante. Or, une fois n’est pas coutume, se mesurer à ce chef-d’œuvre précis n’a rien de sacrilège.
D’une part, Werner Herzog a d’ores et déjà prouvé la validité de la démarche en offrant en 1979 un remake magnifique et distinct — du film originel. D’autre part, Nosferatu est, à la base, une adaptation non autorisée de Dracula (1897), de Bram Stoker, roman ayant inspiré un nombre incalculable de films.
Bref, devant la résurrection, si l’on peut dire, de ce vampire-là, il n’y a guère lieu de crier à l’hérésie.
S’il conjugue intelligemment le meilleur des deux Nosferatu précédents, Eggers, comme Herzog avant lui, ne se borne pas à reproduire ce qui est venu avant.
Ainsi, lors des séquences nocturnes, avec cette direction photo tout de noir et de nuances de bleus, on se rapproche de l’effet produit par le noir et blanc contrasté de Murnau jadis. Les macabres tableaux qu’Eggers est si doué pour imaginer sont en ces occasions à leur plus saisissant.
Dans les scènes se déroulant durant le jour, les couleurs sont délavées, exsangues. C’était le cas de la version d’Herzog, qui se caractérisait par un dénuement formel exsudant une poésie sépulcrale. Eggers paraît s’en être inspiré, délaissant la surenchère de son précédent The Northman (L’homme du nord) : un choix heureux qui permet aux quelques élans baroques, car il y en a, de résonner plus fort encore.
Photo: Focus Features Dans les scènes se déroulant le jour, les couleurs du film sont délavées.
À terme, le cinéaste transcende toute notion de mimétisme en insufflant à sa vision gothique un souffle quasi épique. Des passages vus des tas de fois dans les différents Nosferatu et Dracula, telle l’arrivée du carrosse fantôme, voient ainsi leur pouvoir d’envoûtement renouvelé à la faveur d’une mise en scène alliant intimisme et grand déploiement.
Visuellement, ce nouveau Nosferatu est le film le plus ambitieux et sans doute le plus achevé du cinéaste à peine quadragénaire. Il faut dire que le projet était en développement depuis près de dix ans : c’est dire que Robert Eggers a eu tout loisir de visualiser la production dans ses moindres détails.
D’ailleurs, dans un entretien au Devoir à la sortie de The Witch, qui marquait ses remarquables débuts derrière la caméra, Eggers avait cette confidence éloquente : « Dès lors qu’il s’agit d’épouvante, je préfère qu’on s’en remette à l’imagination. Je ne veux pas voir les chevilles de Christopher Lee en Dracula : sa cape doit se fondre avec les ténèbres, comme dans une peinture de Rembrandt. »
Toujours au sujet du premier film d’Eggers : l’Ellen revue et bonifiée de ce Nosferatu-ci a beaucoup en commun avec la Thomasin de The Witch. Dans les deux cas, on parle de jeunes femmes coincées dans des milieux étouffants, aux valeurs étriquées, et qui s’émancipent en embrassant les ténèbres. Fait intéressant : Ralph Ineson joue le patriarche puritain dans The Witch, et le docteur engoncé dans la misogynie ordinaire dans Nosferatu.
À noter qu’Eggers a ajouté ce sous-texte, qu’il renforce en transformant le supposé amour du comte vampire pour Ellen en une soif de domination. Il veut qu’elle se soumette à lui, comme il l’énonce clairement en lui lançant un sinistre ultimatum (dont la teneur engendre des longueurs tardives). Dès lors, la décision finale d’Ellen relève de l’autodétermination : une autre variante inédite.
Photo: Focus Features L’Ellen (Lily-Rose Depp) revue et bonifiée de ce Nosferatu-ci a beaucoup en commun avec la Thomasin de «The Witch».
Dans la même optique, Eggers ouvre son Nosferatu non pas avec Thomas, comme Murnau, mais avec Ellen, comme Herzog. Par la suite, Ellen est souvent celle qui propulse l’action, là où les itérations passées du personnage faisaient un peu figure de potiches apeurées. Quoique, dans le film de 1979, le jeu hanté d’Isabelle Adjani captive.
Parlant d’Adjani, il est évident que sa performance hallucinante dans le culte Possession, d’Andrzej ?u?awski, a en partie inspiré celle, fascinante également, de Lily-Rose Depp. Sa composition habitée, totalement désinhibée, frappe l’imaginaire, à l’instar du film.
Et c’est ainsi qu’à son tour, Robert Eggers réussit à effrayer et à séduire, avec ce Nosferatu pourvoyeur de splendides cauchemars à venir.
François Lévesque (Le Devoir)